Le risque que courent les chiites face aux agressions sectaires dans plusieurs pays amène certains d’entre eux à cacher leur identité chiite dans l’espoir d’éviter persécution, discrimination ou violence. Dans cet article, j’analyse pourquoi cette stratégie de dissimulation devient une nécessité dans des contextes où l’appartenance religieuse expose à des menaces réelles.
Face à l’hostilité sectaire dominante, les chiites sont parfois contraints à vivre en marge, dans une sorte de double vie, pour préserver leur sécurité et leur liberté. Je présenterai des statistiques crédibles sur les agressions, assassinats et violences envers les chiites dans divers pays, avant d’explorer les motivations de cette dissimulation. Pour découvrir plus sur le chiisme, consulter le menu du site et découvrez toutes les catégories.
Découvrez plus sur le Chiisme !
Sommaire
Contexte historique de la dissimulation identitaire
Depuis les premiers siècles de l’islam, les chiites ont souvent été contraints de cacher leur identité religieuse pour échapper à la persécution. Cette dissimulation, connue sous le nom de taqiyya, est née dans un contexte de danger réel, où déclarer son appartenance à l’école des Ahlul Bayt pouvait coûter la vie.
Durant les époques omeyyade et abbasside, de nombreux adeptes d’Ali (a) furent arrêtés, torturés ou exécutés, poussant les chiites à pratiquer leur foi secrètement.
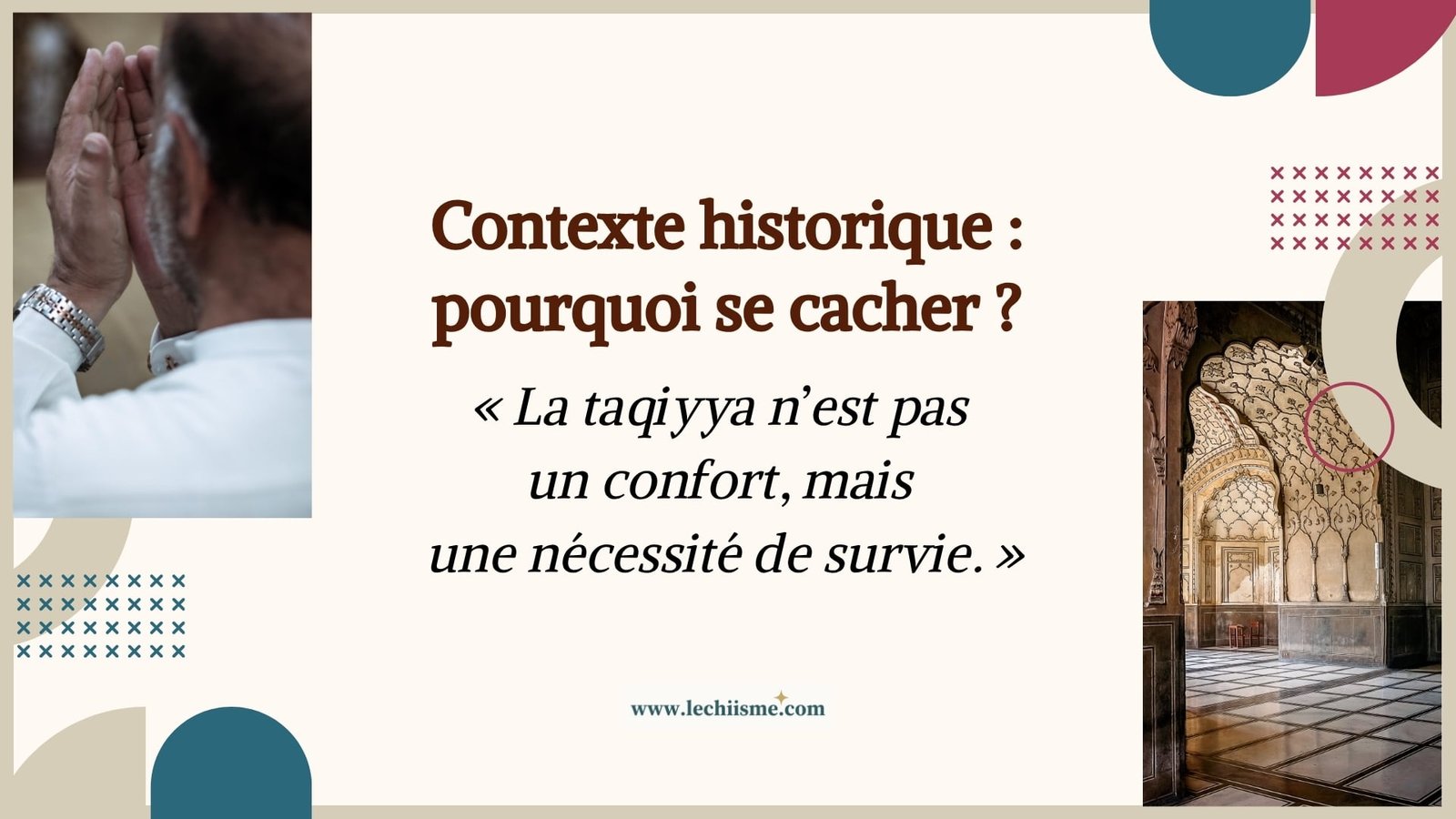
Ce phénomène n’était pas un choix de confort, mais une stratégie de survie pour préserver la vie, la famille et la transmission du message prophétique authentique.
Lisez plus : Quel est le Coran des Chiites ?
Le danger subi par les chiites dans l’histoire
Les persécutions contre les chiites ne se limitent pas à une époque particulière : elles s’étendent sur plus de quatorze siècles d’histoire.
D’après plusieurs sources historiques, des massacres collectifs, des déportations et des exécutions de masse ont été perpétrés contre les chiites dans de nombreuses régions du monde musulman.
Ces violences ont marqué chaque siècle, du califat omeyyade jusqu’à l’ère moderne, où les attaques contre les communautés chiites se poursuivent encore au Pakistan, en Afghanistan et au Nigéria.
I. Sous les Omeyyades et les Abbassides
Sous le règne de Muawiya et de Yazid, des milliers de chiites furent tués, notamment après la tragédie de Karbala (680). Les gouverneurs omeyyades tels que Hajjaj ibn Yusuf ont exécuté massivement les partisans de l’Imam Ali (a).
Des rapports historiques mentionnent jusqu’à 100 000 victimes chiites durant cette période.
Sous les Abbassides, malgré leur promesse initiale de justice envers la descendance du Prophète (s), la situation empira : les descendants d’Ali (a) furent emprisonnés, exilés ou assassinés sur ordre des califes, notamment Al-Mansour et Al-Mutawakkil.
Ces périodes sanglantes ont conduit à l’exil forcé de milliers de familles chiites vers la Perse, le Yémen et le Maghreb. Les sources montrent que même les savants chiites furent systématiquement éliminés ou censurés, leurs bibliothèques brûlées, et leurs noms effacés des registres officiels.
Lisez plus : Les musulmans africains sont-ils sunnites ou chiites ?
II. Les persécutions médiévales
Les dynasties suivantes, comme les Ghaznévides et les Seldjoukides, ont poursuivi la politique d’élimination des chiites. Le sultan Mahmoud de Ghazni déclara publiquement qu’il tuerait « tout rafidhi trouvé dans son royaume ».
Des milliers de chiites furent exécutés, et d’autres contraints de se convertir au sunnisme pour survivre.
En Afrique du Nord, les chiites du Maghreb furent massacrés par les dynasties berbères telles que les Almoravides et les Zîrides.
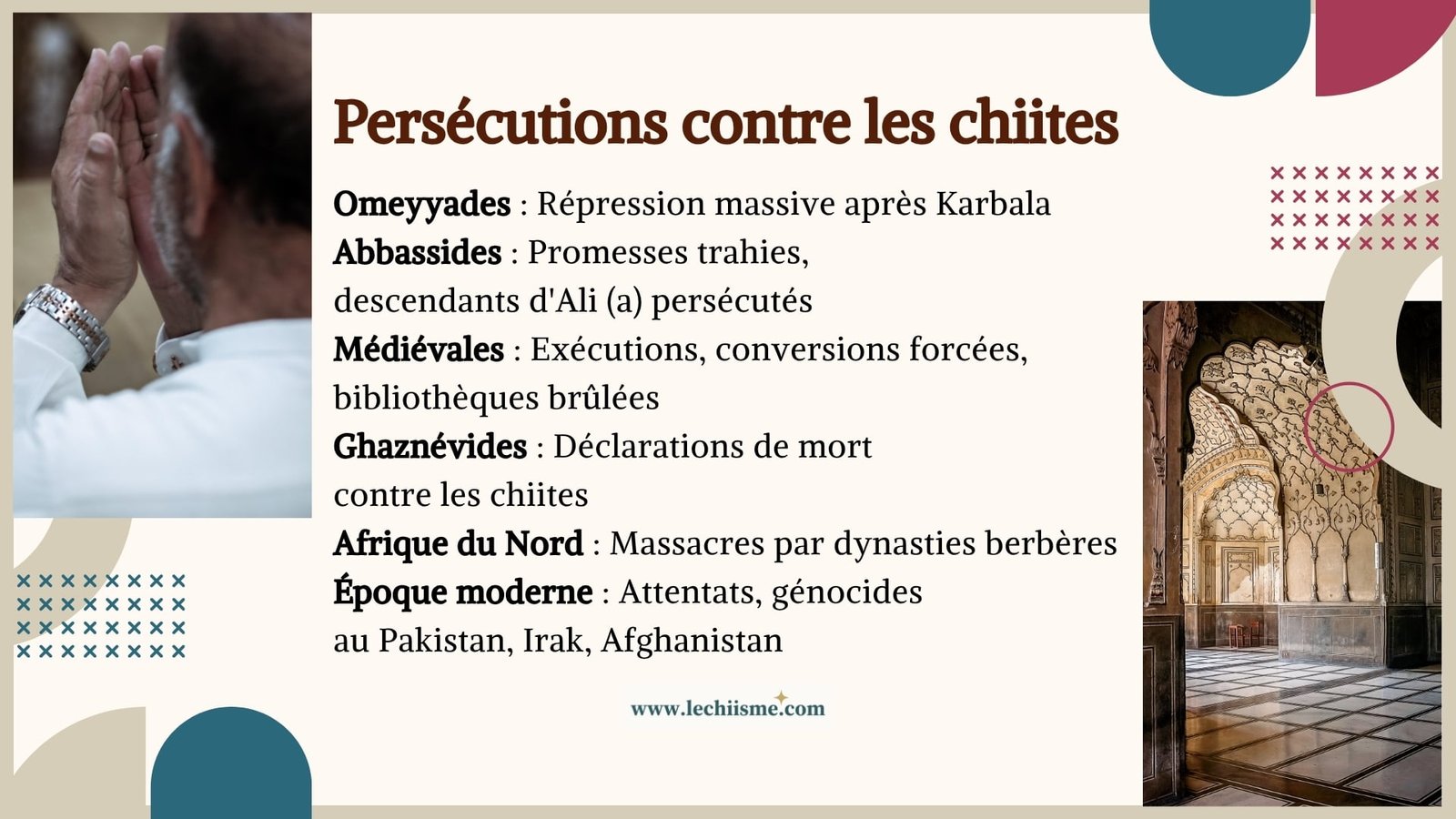
Les sources rapportent également la destruction de grandes bibliothèques chiites sous les Ayyoubides, notamment par Salah ad-Din al-Ayyubi, qui fit brûler la bibliothèque fatimide du Caire contenant plus de 200 000 manuscrits, effaçant ainsi une partie majeure de l’héritage intellectuel chiite.
III. Les massacres modernes
Au XXe et XXIe siècle, les violences contre les chiites ont pris la forme de massacres ciblés et d’attentats terroristes. Selon les statistiques de Human Rights Watch et d’autres organisations, plus de 35 000 chiites ont été tués au Pakistan entre 1989 et 2022, notamment dans les régions du Baloutchistan et de Parachinar.
En Afghanistan, les Hazaras chiites ont subi plusieurs vagues de génocide, de l’époque d’Abdur Rahman Khan jusqu’aux attaques récentes de Daesh et des Talibans.
En Irak, depuis 2003, les attentats de groupes extrémistes sunnites comme Al-Qaïda et Daesh ont causé la mort de plus de 100 000 chiites, sans compter les enlèvements, destructions de mosquées et déplacements forcés.
Ces chiffres montrent que la haine sectaire reste une menace mondiale pour les chiites, même à notre époque moderne.
Lisez plus : Quelles sont les croyances islamiques d’après les chiites ?
Le danger subi par les chiites selon les pays
Dans plusieurs régions du monde, les chiites continuent de subir de graves violences, des discriminations systématiques et des massacres. Ces persécutions prennent des formes différentes selon les pays : attaques terroristes, exécutions ciblées, privations de droits civiques ou encore interdiction d’exercer leur culte.
Les données historiques et contemporaines montrent que le danger pour les chiites est global, touchant des pays d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique. Voici un aperçu des situations les plus marquantes documentées dans les rapports et archives historiques.
I. Pakistan
Le Pakistan est l’un des pays les plus dangereux pour les chiites. Depuis les années 1980, plus de 35 000 chiites ont été assassinés selon Human Rights Watch.
Les groupes extrémistes comme Lashkar-e-Jhangvi et Sipah-e-Sahaba ont mené des attaques massives contre les Hazaras à Quetta, les fidèles à Parachinar et les pèlerins vers l’Iran.
Des mosquées chiites ont été bombardées, et des processions religieuses visées à plusieurs reprises.
II. Afghanistan
Les chiites hazaras d’Afghanistan ont subi plusieurs vagues de massacres. Sous le règne d’Abdur Rahman Khan (fin XIXe siècle), plus de 60 000 Hazaras furent tués ou réduits en esclavage.
Ces violences se sont poursuivies sous les Talibans, puis avec Daesh qui a attaqué des mosquées à Kaboul et Mazar-e-Sharif. En 2021 et 2022, plusieurs attentats ont tué des centaines de fidèles chiites lors de la prière du vendredi.
III. Irak
Depuis la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, les chiites d’Irak ont subi des attaques incessantes. Al-Qaïda puis Daesh ont orchestré des attentats-suicides contre des villes saintes comme Karbala, Najaf et Bagdad.
Entre 2003 et 2017, plus de 100 000 chiites ont été tués selon les rapports du gouvernement irakien et de l’ONU. Les sanctuaires chiites ont aussi été profanés et visés par des bombes.
Lisez plus : Qui sont les plus radicaux, chiites ou sunnites ?
IV. Bahreïn
Au Bahreïn, la majorité de la population est chiite mais le pouvoir reste entre les mains d’une minorité sunnite. Les chiites y sont privés de représentation politique, subissent des arrestations massives et des tortures.
Depuis les manifestations pacifiques de 2011, plus de 4 000 prisonniers politiques chiites sont toujours détenus selon Amnesty International.
V. Arabie saoudite
Les chiites d’Arabie saoudite, principalement installés dans la province orientale de Qatif, sont soumis à une discrimination religieuse et économique structurelle.
Des dizaines de figures religieuses chiites ont été exécutées, dont le célèbre cheikh Nimr al-Nimr en 2016. Les mosquées chiites sont surveillées, et la pratique publique de leurs rituels est restreinte.
VI. Inde
En Inde, bien que les chiites jouissent d’une certaine liberté religieuse, ils ont été victimes de violences communautaires dans certaines régions comme le Cachemire.
Les tensions entre groupes extrémistes sunnites et chiites ont conduit à des assassinats ciblés et à des attaques contre des processions d’Ashoura.
Les chiites du Cachemire font également face à une marginalisation politique et sociale documentée par des ONG locales.
VII. Nigeria
Au Nigeria, la communauté chiite subit une répression sévère depuis les années 2010. Le mouvement islamique du Nigeria dirigé par le cheikh Ibrahim Zakzaky a été la cible de l’armée : en décembre 2015, plus de 340 chiites ont été massacrés à Zaria selon Human Rights Watch.
Depuis, les rassemblements chiites sont interdits et les fidèles arrêtés arbitrairement.
VIII. Syrie
Durant la guerre civile syrienne, de nombreux chiites, notamment les Alaouites et les Ismaéliens, ont été attaqués par des groupes extrémistes comme Al-Nosra et Daesh.
Des villages entiers ont été détruits dans les provinces d’Alep, Idlib et Homs. Les mausolées chiites, tels que celui de Sayyida Zaynab à Damas, ont aussi été pris pour cible par des bombardements.
IX. Yémen
Au Yémen, les chiites zaïdites (houthis) ont longtemps subi la domination du régime soutenu par l’Arabie saoudite. Depuis 2015, la guerre a causé plus de 150 000 morts selon l’ONU, dont une grande partie parmi les civils chiites.
Les bombardements saoudiens ont visé des zones majoritairement zaïdites, aggravant la crise humanitaire.
X. Égypte
En Égypte, les chiites représentent une petite minorité, mais sont régulièrement arrêtés ou accusés d’hérésie. Les rapports de l’ONU et d’ONG comme Minority Rights Group signalent des cas de lynchage, de destruction de mausolées et de fermeture des lieux de culte chiites.
La peur de la persécution pousse de nombreux chiites égyptiens à pratiquer leur foi en secret.
XI. Maghreb
Dans les pays du Maghreb, notamment au Maroc et en Algérie, les autorités surveillent étroitement les activités chiites. Bien que les massacres historiques remontent à l’époque des Almoravides et Almohades, la pression religieuse persiste : les chiites sont exclus des postes publics et leurs associations sont souvent interdites.
Les sources historiques rapportent des exécutions massives de chiites au XIe siècle par les Zîrides et les Almoravides.
XII. Iran
En Iran, la majorité chiite a souvent été la cible de puissances étrangères et d’extrémistes sunnites. Avant l’établissement de la dynastie safavide, les chiites iraniens vivaient dans la clandestinité pour échapper aux persécutions des Ghaznévides et des Seldjoukides.
Même après la Révolution islamique de 1979, les sanctuaires chiites ont été visés par des attentats à Mashhad et Téhéran, perpétrés par des groupes liés à Daesh.
XIII. Liban
Au Liban, bien que les chiites disposent d’une représentation politique, ils restent exposés aux tensions régionales. Les guerres avec Israël et les conflits internes ont entraîné des bombardements de zones chiites, notamment à Beyrouth-sud et au sud du pays.
De plus, les groupes salafistes ont mené plusieurs attentats contre les quartiers chiites entre 2013 et 2016.
Lisez plus : Le salafiste est-il sunnite ou chiite ?
Statistiques et cas documentés
Les chiffres disponibles montrent l’ampleur tragique des violences contre les chiites à travers l’histoire et dans le monde contemporain. Ces données, issues de rapports d’ONG, de journaux historiques et de sources académiques, mettent en évidence un schéma constant de massacres, de discriminations et de campagnes de terreur.
Les cas les plus marquants démontrent que la haine anti-chiite n’est pas un phénomène isolé, mais une réalité persistante qui a coûté la vie à des millions de personnes au fil des siècles.
- Pakistan : plus de 35 000 chiites tués depuis 1989 selon Human Rights Watch.
- Afghanistan : environ 60 000 Hazaras exterminés sous Abdur Rahman Khan au XIXe siècle.
- Irak : plus de 100 000 morts chiites depuis 2003 à cause d’attentats et d’attaques sectaires.
- Arabie saoudite : dizaines de religieux chiites exécutés, dont le cheikh Nimr al-Nimr en 2016.
- Bahreïn : plus de 4 000 prisonniers politiques chiites toujours détenus selon Amnesty International.
- Nigeria : environ 340 morts lors du massacre de Zaria en 2015 par l’armée nigériane.
- Yémen : plus de 150 000 civils tués depuis 2015, majoritairement chiites zaïdites.
- Syrie : plusieurs milliers de morts chiites lors des attaques de Daesh et Al-Nosra entre 2012 et 2018.
- Égypte et Maghreb : minorités chiites contraintes à la clandestinité, mosquées détruites et fidèles arrêtés.
- Arabie au XVIIIe siècle : attaques wahhabites menées par Muhammad ibn Abd al-Wahhab et ses partisans,
provoquant la destruction de tombes d’imams et de mausolées à Karbala et Médine, ainsi que le massacre de milliers de pèlerins chiites.
Les historiens estiment que depuis le VIIe siècle, plus de 20 millions de chiites ont été tués ou déplacés de force en raison de leur foi.
Les attaques wahhabites du XVIIIe siècle ont marqué un tournant tragique : sous la direction de Muhammad ibn Abd al-Wahhab et du premier État saoudien, les troupes wahhabites ont envahi Karbala en 1802, massacrant des milliers de chiites et profanant le sanctuaire de l’Imam al-Hussein (a).
Ce massacre, justifié par une interprétation extrémiste du monothéisme, demeure l’un des événements les plus sanglants de l’histoire religieuse islamique.
Conséquences sur la vie quotidienne des chiites
Dans plusieurs pays, les chiites doivent cacher leur identité pour protéger leur vie. Cette précaution n’est pas une forme de dissimulation volontaire, mais une nécessité de survie face à des groupes extrémistes qui considèrent, à tort, qu’il est « obligatoire de tuer » les chiites.
Les croyants sont souvent forcés de ne pas mentionner leurs pratiques religieuses, de prier discrètement, voire d’adopter des prénoms neutres pour éviter les arrestations ou les agressions.
Dans les régions dominées par des idéologies radicales, le simple fait de visiter un mausolée, de célébrer Achoura ou de mentionner l’Imam Ali (a) peut conduire à l’exécution.
Ainsi, la dissimulation identitaire devient un acte de résistance pacifique, une manière de préserver la foi tout en protégeant la vie.
Malgré ces difficultés, les chiites continuent de transmettre leur héritage, leurs enseignements et leur attachement à la famille du Prophète (s), souvent au prix de grands sacrifices.
Lisez plus : Qui est le fondateur du chiisme ?
Où apprendre les dogmes chiites ?
Pour celles et ceux qui souhaitent apprendre les dogmes chiites de manière structurée et authentique, je propose des cours en ligne complets sur mon Institut islamique Razva.
Vous pouvez le chercher sur Google en tapant « Institut islamique Razva », puis cliquer sur le menu pour découvrir mes cours d’islam à distance, disponibles pour tous les niveaux.
Ces cours abordent les fondements de la foi, la théologie chiite et la compréhension des enseignements des Ahlul Bayt (a).
Inscrivez-vous aux cours d’islam chiite à distance
Où trouver des livres chiites en français ?
Pour approfondir vos connaissances, vous pouvez consulter la librairie chiite en ligne, une catégorie dédiée de la boutique Razva.
Vous y trouverez des ouvrages essentiels sur la théologie, l’histoire, la spiritualité et la jurisprudence chiite, traduits en français et accessibles à tous les lecteurs francophones.
Consultez : La librairie islamique en ligne
Conclusion
Les chiites, malgré les persécutions, ont préservé leur foi et transmis les enseignements des Ahlul Bayt (a) à travers les siècles.
Si cet article vous a interpellé, n’hésitez pas à explorer les catégories du site, à lire d’autres articles sur le chiisme et à envoyer vos questions via la page de contact.
Vous pouvez aussi cliquer sur le menu pour découvrir nos autres rubriques et poursuivre votre apprentissage du chiisme en toute liberté et authenticité.
Je vous invite à visionnez les deux pages importantes ci-dessous :
👉 Faites un don, donnez votre khoms ou zakat
👉 Posez votre question religieuse
Commencez à lire :
- Le Coran en français
- Mafatih al-Jinan (Clé du Paradis)
- Ma chaîne YouTube « Le Chiisme »
- Ma chaîne philosophique « L’Émanation »
Articles sur la Géopolitique du chiisme
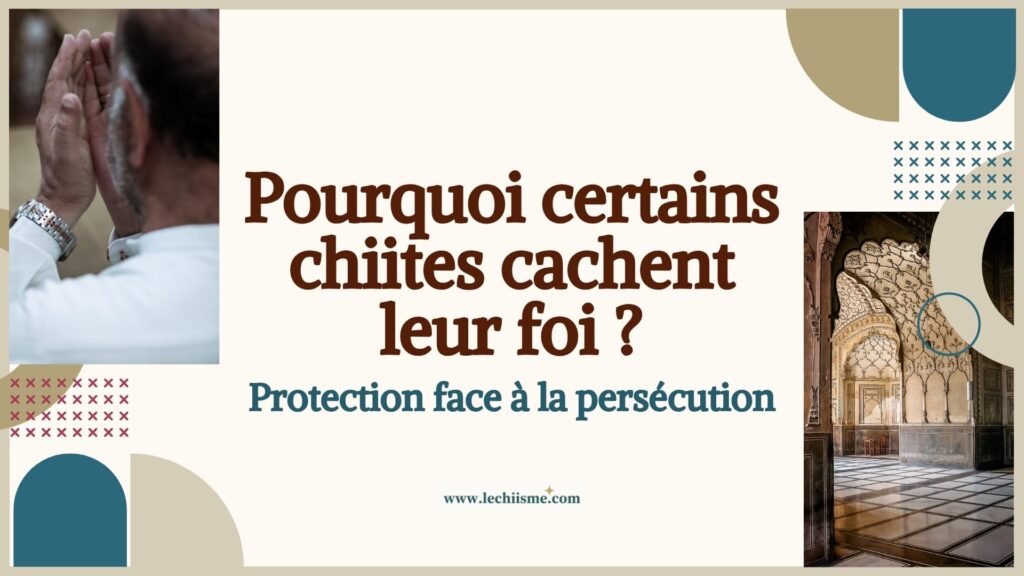
✍️ Rédigé par :
Seyed Ali Mousavi ✦
Spécialiste en sciences islamiques et chiites depuis 2004, je partage réflexions, savoirs et perspectives sur Le Chiisme.
Avec une plume inspirée et une vision éclairée, j'invite chaque âme à explorer l'islam et à cheminer vers un monde meilleur.